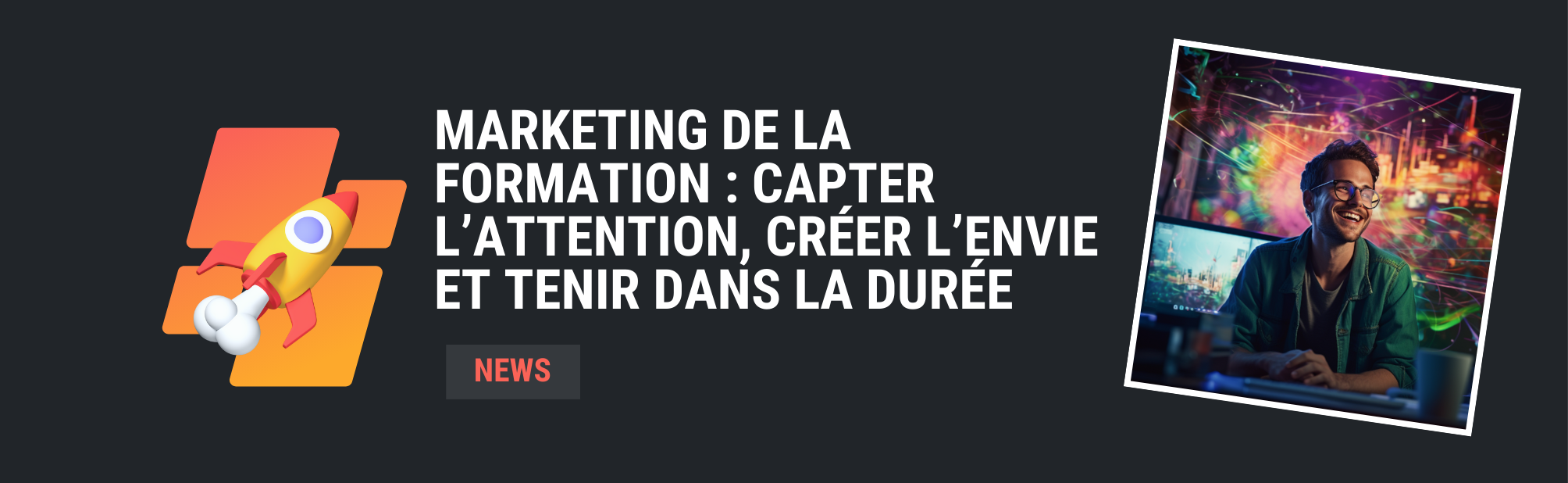Un canal Slack qui s’enflamme, un communiqué bricolé en urgence, des mots qui pèsent trop tard… On connaît la scène. Le devoir de vigilance a été pensé pour éviter ce scénario. Désormais porté par une directive européenne, il oblige les entreprises à prévenir, réduire et, si nécessaire, réparer les atteintes aux droits humains et à l’environnement liées à leurs activités — y compris celles de leurs partenaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Autrement dit : passer du « on s’excuse après » au « on anticipe avant ».
La France a ouvert la voie en 2017 ; l’Europe généralise l’exigence. La responsabilité dépasse les murs du siège et s’étend aux filiales, fournisseurs et sous-traitants. Former vos équipes, c’est donner un langage commun : ce qu’est une atteinte aux droits (travail des enfants, discriminations, déplacements forcés), comment lire les impacts environnementaux (pollution, déforestation, perte de biodiversité), où se logent les enjeux de santé-sécurité, de gouvernance (corruption, détournements) et d’information des consommateurs (qualité, transparence). À la clé : une posture professionnelle plus sûre, des décisions plus nettes, une responsabilité sociale crédible.
Le devoir de vigilance couvre l’humain, l’environnement, le travail, la gouvernance et l’information. Point crucial : il s’applique à toute la diligence raisonnable sur la chaîne de valeur. Fermer les yeux sur un partenaire « lointain » n’est plus tenable. La vigilance attendue est proactive : on identifie, on hiérarchise, on agit en amont. On ne coche pas des cases, on transforme des pratiques.
Tout commence par une cartographie des risques. Où se trouvent les impacts négatifs potentiels — approvisionnement, fabrication, distribution, fin de vie ? Quels indicateurs pour mesurer l’efficacité de nos mesures ?
Vient ensuite la prévention : mécanismes d’alerte accessibles (y compris anonymes), canaux ouverts aux parties prenantes — salariés, communautés locales, ONG —, règles d’achat exigeantes et due diligence renforcée sur les partenaires.
Quand un risque se confirme, on atténue ou on supprime : process revu, correctifs imposés à un fournisseur, matière première remplacée, itinéraire logistique modifié.
Si l’atteinte n’a pu être évitée, on répare et on compense : soutien aux victimes, prise en charge de dommages environnementaux, responsabilités civiles assumées.
Le tout vit dans un plan de vigilance public et mis à jour : risques cartographiés, mesures d’évaluation régulière, actions de prévention et d’atténuation, mécanisme d’alerte et dispositif de suivi. La transparence n’est pas un PDF dormant : c’est un document vivant qui ancre la crédibilité.
Commencez par un diagnostic honnête : d’où viennent nos principaux risques et où sommes-nous aveugles ? Fixez des priorités (tout n’a pas la même criticité), clarifiez les rôles entre juridique, achats, RH, opérations et communication. Évitez les extrêmes : ni la « case à cocher » qui endort, ni le verrouillage qui paralyse. Concentrez-vous sur peu de règles, bien appliquées. Et n’oubliez pas la réalité terrain : si les promesses publiques ne se traduisent pas en actes dans les usines, entrepôts ou boutiques, la marque paie l’addition tôt ou tard.
Le non-respect expose à des sanctions administratives, civiles et financières, parfois indexées sur le chiffre d’affaires. Mais l’enjeu dépasse le bâton : les attentes sociétales montent et ce qui est « optionnel » aujourd’hui deviendra demain un standard. Les entreprises qui anticipent engrangent des bénéfices visibles : moins d’incidents, plus d’engagement en interne, une réputation qui tient dans la durée — et, souvent, de l’innovation née d’une meilleure maîtrise des risques.
Le devoir de vigilance n’est pas une contrainte de plus. C’est un cadre qui aide à mieux voir, mieux décider et mieux prouver. En prenant au sérieux vos impacts — du fournisseur lointain à la boutique de quartier — vous construisez ce qui compte le plus : la confiance. Et la confiance, on le sait, finit toujours par payer.